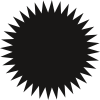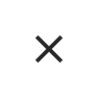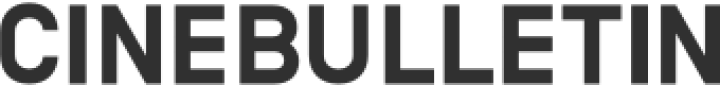Dans « Sorry Cinema », Ahmad Hassouna tente de documenter son incapacité à faire des films comme il en rêvait. © Fonds Masharawi
Une partie du projet « Ground Zero » porté par Rashid Masharawi, cinéaste palestinien originaire de Gaza, a été présentée lors du dernier festival Visions du Réel. Les premiers extraits du film et les réflexions du réalisateur nous plongent déjà au cœur de récits essentiels, témoins des réalités en temps de guerre.
Lors de la présentation de « Ground Zero » au dernier festival Visions du Réel, la salle de l’Usine à Gaz était étrangement clairsemée. Pourtant, l’enthousiasme était palpable, aussi bien pour le public que chez les intervenant·e·s. Parmi ceux·celles-ci, Rashid Masharawi, réalisateur palestinien résidant à Ramallah et originaire de Gaza, dirige le projet. À la fin de 2023, il s’est engagé à fournir en caméras 20 cinéastes de la bande de Gaza, afin qu’ils·elles puissent immortaliser leur quotidien et renforcer le lien avec leur histoire. Au moment de la discussion à Nyon, les 20 courts métrages prévus pour constituer un ensemble de 60 minutes étaient encore en phase de postproduction. Seule une petite sélection des travaux, exclusive, se révélait dans la pénombre du festival, à l’image de « Hill of Heaven », de Kareem Satoum. Dans ce documentaire, le réalisateur se rend dans le camp de réfugié·e·s de Deir al-Balah, cherchant à reconstruire les fragments d’une mémoire dispersée. D’une autre manière, « No », de la réalisatrice Hana Awad, plonge dans les rues de la ville de Gaza aux côtés de son caméraman Ahmad, à la recherche d’un instant de bonheur à immortaliser. Au milieu des ruines et du vacarme assourdissant, surgit miraculeusement une musique, la vie.
Récemment, les professionnel·le·s accrédité·e·s ont eu l’occasion de découvrir l’ensemble de ces films au Marché du film du Festival de Cannes, parmi lesquels figure aussi le documentaire « Out of Frame », de Nidaa Abu Hasna, qui retrace le parcours de Raneen Al-Zarei, une artiste plasticienne originaire du nord de Gaza, obligée de fuir vers Rafah avec sa famille lors des bombardements israéliens. De retour dans son atelier détruit, elle tente de récupérer certaines œuvres tout en évoquant les thèmes au cœur de son travail. Dans « Obsession », de Thaer Abu Zubaydah, le quotidien angoissant de Saeed est mis en lumière. Contraint de coexister avec le bruit incessant des drones israéliens, Saeed s’accommode progressivement de leur présence. Cependant, dès que le silence refait surface, une anxiété grandissante l’envahit, le privant de sommeil sans ce bourdonnement oppressant. De son côté, « Jad and Natalie », d’Aws Al-Banna, dévoile la vie d’un acteur de théâtre de Gaza qui retourne dans son quartier détruit. Il retrouve les ruines d’une maison, au-dessous desquelles repose sa bien-aimée Nour. Ses rêves de mariage sont anéantis, et l’homme reste muet d’émotion. Citons encore, parmi tant d’autres, « 24 Hours », d’Alaa Damo, où l’on suit Musab, un jeune homme de Gaza, lors d’une journée marquante où il échappe aux bombardements alors qu’il se déplaçait vers des zones qu’on lui avait dit être « sûres ».
Au-delà de la guerre
« Toutes ces histoires transcendent la guerre », souligne Rashid Masharawi lors d’un entretien le lendemain de la présentation à Visions du Réel. « Nous avons voulu que chaque cinéaste raconte une histoire spécifique, à la fois captivante sur le plan formel et personnellement significative. Notre intention n’était pas simplement de relater les faits tels qu’ils sont communément présentés dans les médias, mais de partager des récits authentiques et personnels. »
Initié au cours du conflit qui a suivi les attaques du 7 octobre 2023, le projet « Ground Zero » vise ainsi à restituer la singularité du regard des habitant·e·s de Gaza, tout en préservant leur mémoire. « Dès la phase de développement des films, nous avons entamé des discussions approfondies sur le contenu avec chaque artiste. Nous avons débattu des lieux, des techniques de tournage, tout en formant aux aspects techniques celles et ceux qui en avaient besoin. Il a fallu guider certain·e·s participant·e·s tout au long du processus, car beaucoup ne possédaient pas une compréhension complète de la création cinématographique, faute d’école de cinéma à Gaza. »
 Une autre image tirée de « Sorry Cinema », du cinéaste Ahmad Hassoun. © Fonds Masharawi
Une autre image tirée de « Sorry Cinema », du cinéaste Ahmad Hassoun. © Fonds Masharawi
Sur le terrain
Les équipes ont été soutenues par des coordinateur·trice·s chargé·e·s de fournir aux cinéastes les ressources techniques et humaines nécessaires aux réalisations, ainsi que de gérer et de suivre les budgets. Ces professionnel·le·s ont également assuré le transfert des données hors de Gaza pour la postproduction. Rashid Masharawi souligne : « Pendant la guerre, ces envois numériques représentent un véritable casse-tête. Parfois, cela fonctionne pendant des heures, parfois il n’y a aucune connexion pendant cinq jours d’affilée. Il faut faire preuve de patience, car même une pause de quelques minutes peut retarder tout le processus. On peut passer une journée entière à télécharger un seul fichier. Chaque matin, c’est comme jouer à la loterie. »
Rashid Masharawi poursuit : « Les tournages ont été difficiles. Les équipes avaient aussi des besoins essentiels à satisfaire, comme tout le monde. Trouver de la nourriture, du bois pour se chauffer, assurer la sécurité de la famille. Certain·e·s ont perdu des proches pendant le tournage. Nous leur avons apporté un soutien moral pour les encourager à continuer. Nous nous sentons très proches d’eux·elles et de leurs préoccupations. Par exemple, l’une des réalisatrices a aussi dû jongler entre les soucis de sa fille en colère et la recherche de médicaments pour sa mère. Il fallait rester à l’écoute, discuter et offrir notre aide, même en dehors du cadre du film. »
Pour donner vie à cette initiative, Rashid Masharawi a créé le Fonds Masharawi pour les films et les cinéastes de Gaza. Les recettes générées par le projet seront entièrement reversées à ce fonds. Puis d’autres partenaires se sont également ajoutés, et une campagne de levée de fonds auprès de donateurs privés a été menée. Des personnalités telles que le cinéaste suisse Nicolas Wadimoff (Akka Films) et la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, membre du jury de Visions du Réel 2024, contribuent, à leur échelle, à visibiliser « Ground Zero ».
Selon la société de production française Coorigines Production, chargée de la coordination, de la gestion administrative et de la postproduction en France, le succès du projet repose sur un engagement financier « rapide et sans réserve des partenaires désireux de soutenir cette initiative ». Laura Nikolov, fondatrice de Coorigines Production, conclut : « L’idée d’avoir vingt cinéastes différent·e·s, chacun·e offrant une facette unique de la situation à laquelle ils·elles sont confronté·e·s et y répondant avec des attitudes et des pensées variées, permet de souligner ce qui est commun, ce qui revient. Cet ensemble offre une belle opportunité de rendre compte de la situation là-bas, avec toutes les réflexions qu’elle suscite sur l’être humain, sa dignité, et cet espoir auquel il s’accroche. »
Guillaume Esmiol : «Le plus important reste l’interaction avec l’industrie internationale»
Propos recueillis par Adrien Kuenzy
15 mai 2024