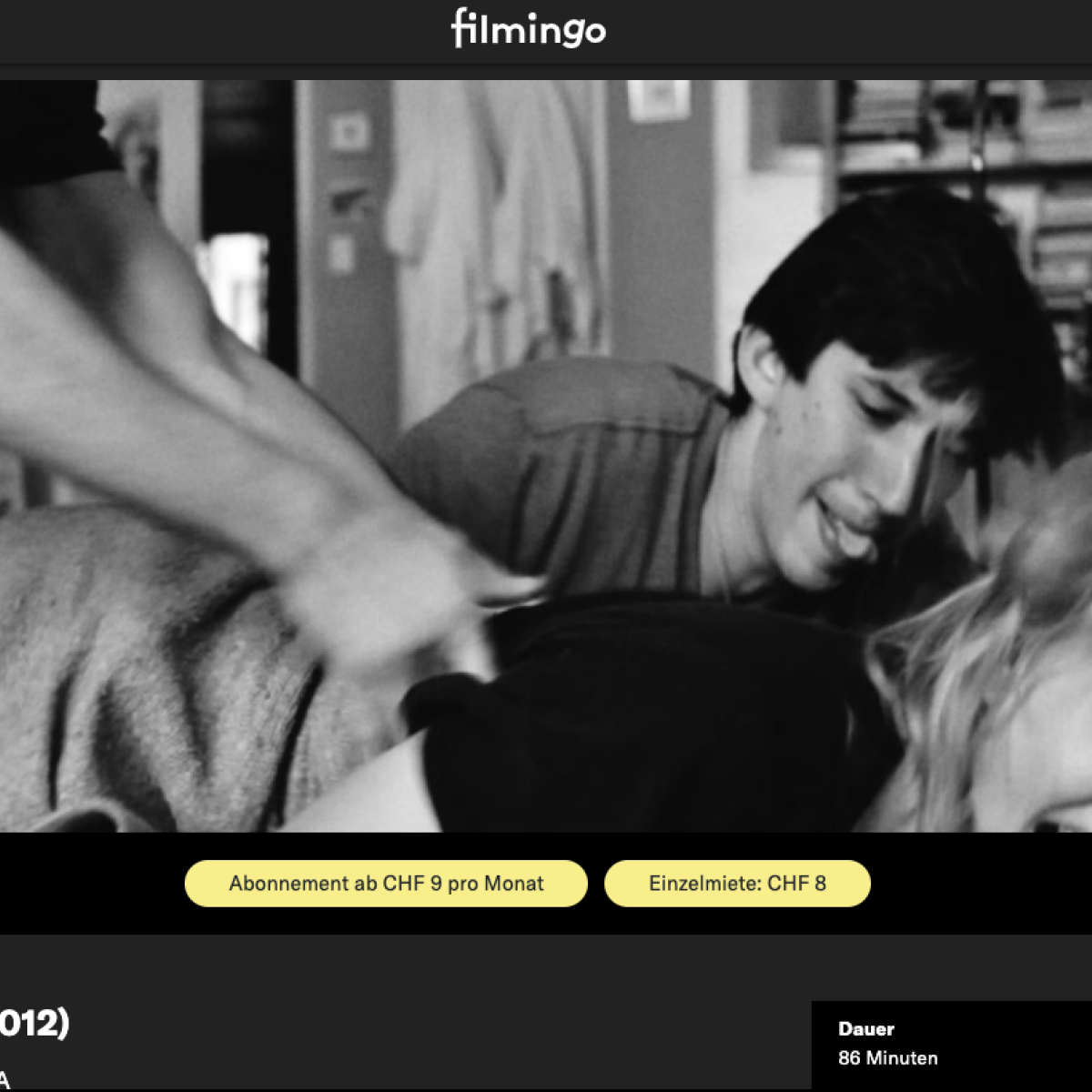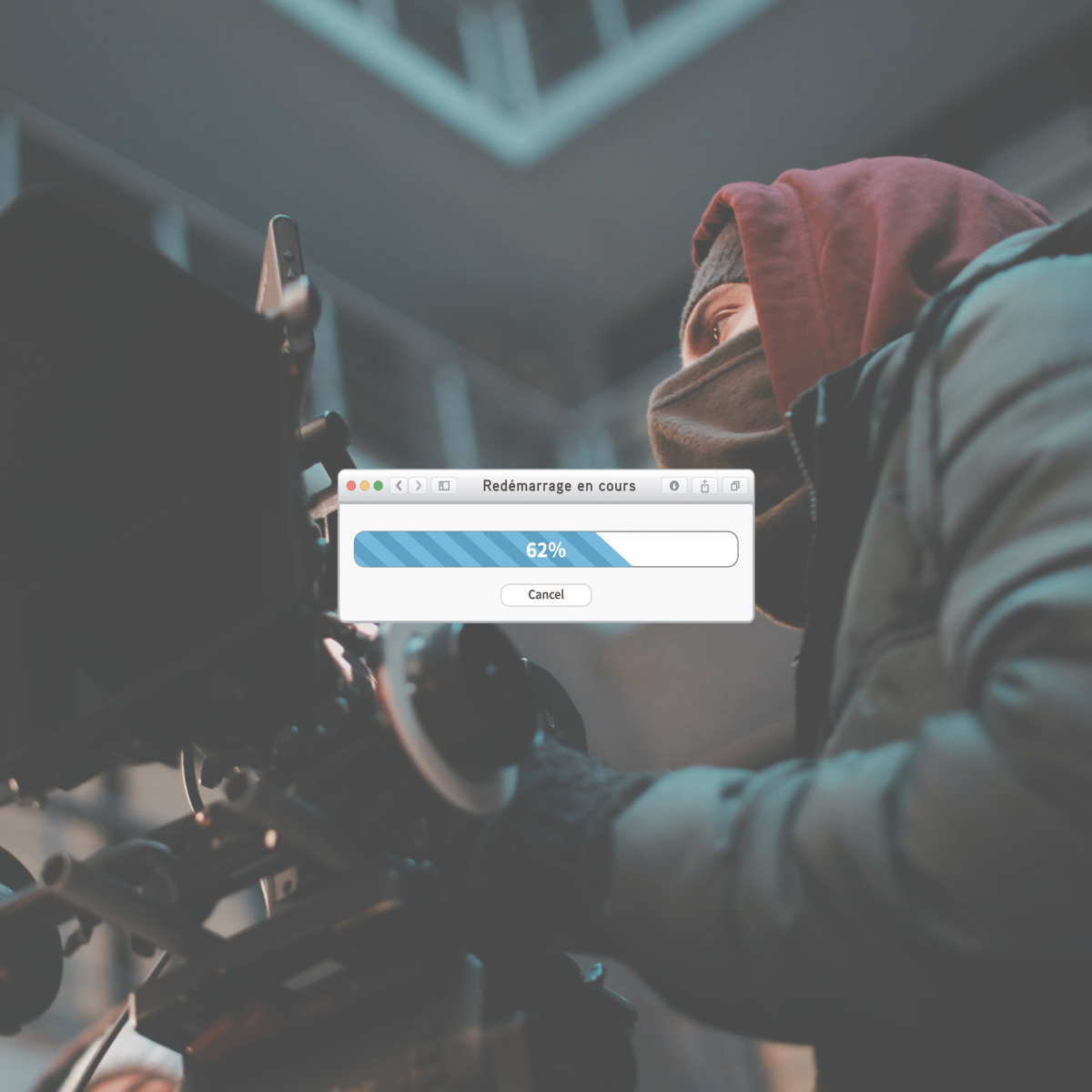n°518
Editorial
La loi des plus faibles
Lire un texte de loi (à part pour quelques juristes), ce n’est pas exactement un divertissement formidable. Et pourtant, on y déconstruit quelques idées reçues bien ancrées. Par exemple, il existe bel et bien un statut d’intermittent·e en Suisse (des salariés aux « changements fréquents d’employeur », pour citer le texte), ce statut est national et pas uniquement genevois ou romand. Dans la courte liste des professions qui peuvent prétendre à ce statut, aux côtés des artistes et des technicien·ne·s, les journalistes. J’en connais bien peu qui, malgré leur passage au chômage, sont au courant de leur mention dans l’ordonnance sur l’assurance-chômage.
La crise nous aura montré avec une certaine violence que les statuts des un·e·s et des autres sont loin d’être clairs, que le cumul des activités peut devenir un cumul des difficultés et que la notion de choix, là au milieu, n’est pas toujours évidente. Un statut d’intermittent·e mieux connu et reconnu, voire un régime spécial capable de rassembler au-delà du Röstigraben et jusqu’à la retraite, libérerait les artistes de l’image de chômeur·euse qui leur colle à la peau. Le monde politique et le grand public doit comprendre qu’un·e intermittent·e est un·e professionnel·le légitime à partir du moment où il·elle cotise de 4 à 5 mois par an, mais qu’il·elle doit bien payer son loyer toute l’année. L’enjeu, on le voit en temps de crise, est simplement de permettre aux gens d’exercer leur métier.
Autre surprise, la Constitution prévoit que « les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif » au chômage. Dans les faits, ce n’est pas le cas, ni la loi ni l’ordonnance d’application ne le permettent. Là aussi, c’est un chantier possible, pour la culture. Il ne s’agit pas de faire la révolution, mais de demander que l’article constitutionnel entre effectivement en vigueur, qu’on tienne, en tant que collectif, notre propre parole. Cette possibilité a déjà été discutée en détail en 2008 lors de la crise financière et jugée impraticable à grande échelle pour des raisons techniques. Pourquoi ne pas la raviver pour certains secteurs ?
Quoi qu’il en soit, et sans prétendre répondre à cette question en quelques lignes lapidaires, à l’heure où la numérisation – et la pandémie – bouleverse le marché de l’emploi, les distinctions rigides entre salarié·e·s et indépendant·e·s font-elles encore sens ? Notre couverture sociale est-elle adaptée aux métiers et aux pratiques atypiques comme le travail sur appel, la multiactivité, la « fausse indépendance » ou le télétravail généralisé ?
Si on veut continuer de parler de professionnalisation du cinéma suisse, il faudra parler après cette crise de son volet social. Un·e professionnel·le est quelqu’un·e qui doit pouvoir changer d’emploi, évoluer, être rattrapé·e par un filet lors des périodes troubles et toucher une retraite qui ne condamne pas aux prestations complémentaires. Sinon, c’est un·e passionné·e qui n’attend pas de son hobby qu’il mette du pain sur la table ou du beurre dans les épinards. Et l’audiovisuel, c’est du bricolage.
Un texte de loi, ce n’est pas juste rébarbatif, c’est l’expression de la manière dont une société s’organise concrètement. Une constitution est un texte fondateur de notre vivre ensemble, et donc de notre travailler ensemble. Une société est aussi solide que les plus faibles de ses membres ; ici, celles et ceux dont la couverture sociale est la plus fragile.
Pascaline Sordet